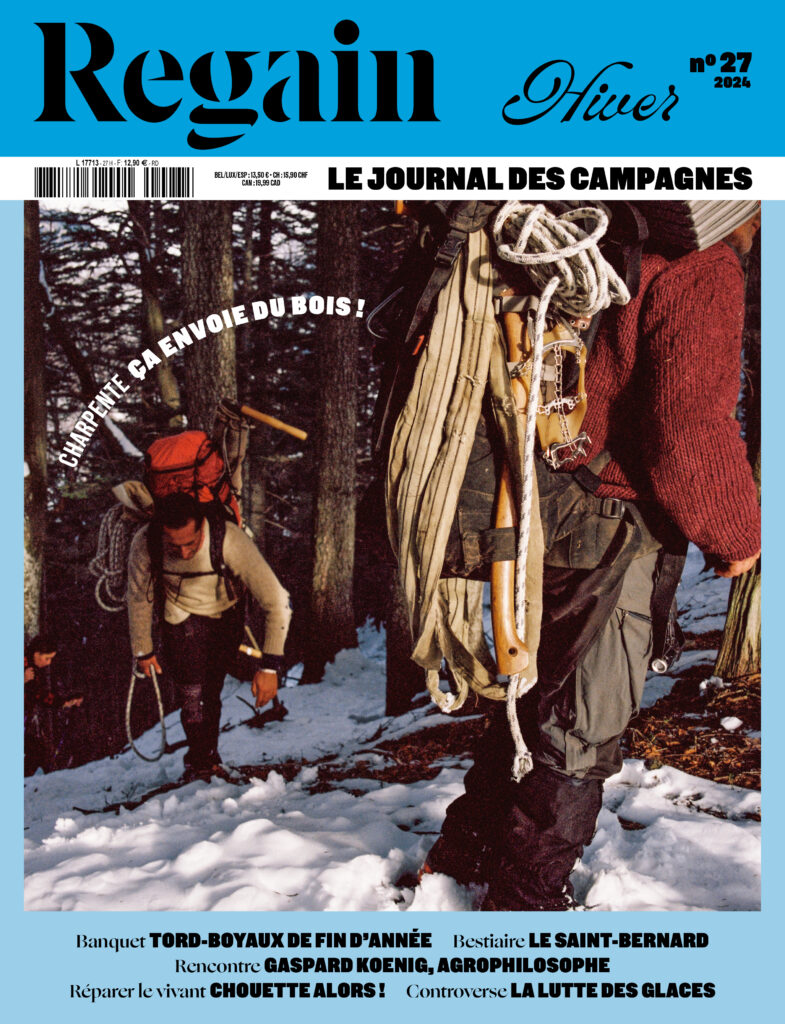Francis Hallé a l’habitude de recevoir chez lui, à Montpellier, dans un appartement sur deux étages habité par sa famille et les plantes issues de graines rapportées de ses expéditions tropicales. Depuis la fenêtre de son bureau, il a une vue imprenable sur les frondaisons du grand chêne, l’un des quatre maîtres du jardin. L’accompagnent le cyprès, le pin pignon et le cèdre. Le jardin est celui de la copropriété. Francis Hallé s’en occupe depuis vingt-cinq ans avec l’aide d’un jardinier devenu entre-temps son ami. Naturellement, il propose de commencer la conversation dehors. Passé l’allée de bambous vieille d’un siècle, il nous présente le Sophora japonica mutant et tortueux. Ses branches poussent vers le sol. Le faux poivrier porte des feuilles à l’odeur d’anis et une baie rose que l’on utilise en cuisine. Le buis vient des Baléares, le laurier de Californie ; le cèdre mesure 33 mètres, le pin 42. Le plaqueminier dresse ses kakis vers le ciel azur quand ses congénères sont le plus souvent taillés à hauteur d’homme. C’est plus pratique pour en cueillir les fruits…
Francis Hallé : Le plus gros problème avec l’être humain, c’est qu’il se croit beaucoup plus malin que les plantes. Il est tout le temps en train de les tailler, les déplacer, les remuer…
Avez-vous une relation intime avec les arbres et les plantes ?
Ma relation avec eux est empreinte d’une sympathie… qui existe j’espère de part et d’autre, mais ça, je ne le saurai jamais ! Mettre des sentiments là-dedans serait tomber dans l’anthropomorphisme. Et je déteste ça. Je vis avec eux, sans qu’on se fasse de tort ni à l’un ni à l’autre. C’est déjà énorme. Ils aimeraient bien que ça soit toujours comme ça.
Qu’est-ce qui vous a attiré en premier lieu vers le monde végétal ?
Je crois que c’est l’esthétique. Si vous prêtez attention à n’importe quelle plante, quelle que soit l’échelle, vous reconnaîtrez que c’est très beau. J’ai dessiné la première quand j’étais étudiant. Sur mon balcon, j’ai vu une plante dont je ne m’étais jamais occupé. Je ne l’avais pas mise là. Elle était dans un pot avec de la terre. Je l’ai vue grandir, fleurir, fructifier, mourir. Et l’année d’après, il y en avait dans tous les pots. Je l’ai dessinée. On était en 1957. Je ne connaissais pas son nom. Je sais aujourd’hui que c’était Capsella bursa-pastoris (la Bourse à pasteur). C’est une adventice. Je pourrais imaginer une plante laide, mais je n’en trouve pas. L’intérêt réel est venu dans un deuxième temps, dans les serres du Muséum d’histoire naturelle à Paris, et puis dans les Tropiques. J’avais exactement 20 ans lors de mon premier terrain, en Côte d’Ivoire.
Oui, mais qu’est-ce qui vous a poussé à étudier la botanique ?
Pendant la guerre, on a très bien vécu en Seine-et-Marne sur un hectare. Mon père était agronome. On était neuf, deux parents et sept enfants, et on a mangé à notre faim. J’avais 6 ou 7 ans, je mettais la main à la pâte, bien sûr. Nous n’avons jamais manqué de rien, et on aidait même les gens du village qui eux n’avaient pas la chance d’avoir un hectare à cultiver. Mon attachement pour les plantes vient d’une sorte d’admiration.
Dès qu’on a de la terre avec des plantes, on a de quoi manger, de quoi se chauffer. Le végétal est toujours utile. Toutes les plantes qui nous entourent ici nous permettent de respirer.
Existe-t-il des arbres immortels ?
Oui, certaines espèces sont capables de se reproduire par drageons : les racines donnent des multitudes de petits arbres qui peuvent devenir une forêt issue d’une graine unique. Et ça peut durer des dizaines de milliers d’années. Pour d’autres arbres, les branches poussent, elles touchent le sol et s’enracinent avant de donner de nouveaux arbres qui feront pareil. Tant qu’il y a de la place et que les conditions sont bonnes, ça continuera comme ça. Vous voyez bien que c’est immortel. Au niveau mondial, on a dû identifier une vingtaine d’espèces d’arbres immortels. Le plus vieux est en Tasmanie, il s’appelle Laumatia tasmanica. Il y a trois kilomètres de clones le long d’une rivière. Il faut analyser le génome pour comprendre que c’est UNE graine. Il ne faut pas s’imaginer que les arbres immortels sont gigantesques. Au-delà de deux mille ans, les arbres se changent en clones. Nous, on n’est pas du tout capables de faire ça.
Francis Hallé nous guide vers son salon envahi de plantes tropicales et nous présente.
F.H.: Celle-ci s’appelle Monstera deliciosa car elle donne une fraise géante et délicieuse à manger. Les forêts tropicales regorgent de ce genre de trésor.
Comment l’idée du radeau des cimes est-elle venue ? (« Le radeau des cimes » est un programme d’expéditions scientifiques sur la biodiversité de la forêt mené par Francis Hallé avec certains acolytes.)
En 1982, au Panama et au Brésil, Terry Erwin est le premier à recenser les insectes d’une canopée de forêt tropicale. Comme il ne pouvait pas monter, même à l’aide de cordes, il utilisait une technique un peu douteuse.
Il tirait vers la canopée avec un canon à gaz toxique, posé au sol, ça tuait les insectes qui retombaient sur de grands draps blancs au sol. Beaucoup se cramponnaient en mourant. Grâce à ce travail de recensement, le comptage de la biodiversité terrestre a été multiplié par dix. On est passé de 3 millions à 30 millions. À partir de ce moment, mon
objectif était clair : je voulais faire comme Terry, mais en montant. J’ai commencé par chercher un pilote de ballon dirigeable. On a ensuite trouvé l’architecte pour concevoir la structure. On passait trois mois sur le terrain, le temps de monter le camp, puis deux mois avec les scientifiques et deux semaines pour démonter. Nous écrivons un livre sur ces trente ans d’exploration de la canopée avec le pilote, l’architecte et le logisticien : Dany Cleyet-Marrel, Gilles Ebersolt et Olivier Pascal. On a des milliers de photos qui n’ont jamais été utilisées.
Quels souvenirs vivaces gardez-vous de ces expéditions ?
Je vais faire référence à mes premières minutes sur la canopée, en Guyane, en 1986. On était depuis des jours dans les sous-bois de la forêt. C’est sombre, ça sent la feuille morte et le champignon, la vieille cave. On monte, on se pose sur la canopée pour la première fois. Et là, j’ai un sentiment extraordinaire. Je suis submergé de parfums floraux extrêmement nombreux et mélangés qui arrivent avec le vent. Puis je suis saisi par la vue d’un énorme charançon bleu fluo. On pouvait être sûr que nous n’étions pas en bas ! J’ai pensé à Terry Erwin : la bio- diversité dépasse les 30 millions. En fait on n’en sait rien, cela dépasse certainement ce que l’on peut imaginer, c’est astronomique.
Cette découverte odorante provoque quelque chose chez vous ?
Je prends là la décision de me consacrer à l’étude de la canopée, l’endroit le plus vivant du monde. Je n’ai pas arrêté depuis. C’est là qu’il y a la plus haute diversité biologique.
Au fil de vos découvertes, votre définition de l’arbre a-t-elle évolué ?
C’est une question très douloureuse, car je n’ai jamais pu faire une définition de l’arbre. Chaque nouvelle balade dans les Tropiques foutait en l’air la définition précédente. La dernière fois, j’étais tout content de la demi-page que j’avais écrite sur le sujet. Je suis invité à l’Université de Pretoria, en Afrique du Sud. Et on me montre des arbres sou- terrains ! Je ne l’ai donc jamais publiée. J’ai totalement laissé tomber l’idée de la définition de l’arbre. De toute façon, quand je dis le mot arbre, tout le monde comprend ! La notion d’arbre tient la route, la définition, ça, c’est autre chose.
À propos de terminologie, l’« intelligence » est-elle un mot que l’on peut appliquer aux arbres ?
Très longtemps, j’ai refusé d’utiliser ce terme d’intelligence, car la définition que je trouvais dans les dictionnaires ne convenait pas aux plantes : il fallait avoir un gros cerveau, la parole et la capacité de se déplacer. Comme les plantes ne font rien de tout ça, elles n’étaient pas intelligentes. Un collègue canadien, Jeremy Narby, m’a suggéré de réécrire la définition de l’intelligence sans qu’il apparaisse qu’un être humain l’a écrite. On a publié cette définition dans Intelligence dans la nature (Buchet-Chastel, ndlr). Je peux vous la résumer ici : est intelligent tout être vivant capable de faire face aux difficultés qu’il rencontre dans sa vie. Cette capacité repose sur deux talents : savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui est appris pour pouvoir l’utiliser ensuite.
Quelle est la différence entre être fixe et être immobile ?
La plante, face à un danger, un changement climatique, ne peut pas se sauver. Soit elle meurt, soit elle résout le problème. Donc, selon notre nouvelle définition, les plantes sont intelligentes. Après tout, cette définition de l’intelligence s’applique également à l’être humain, à tout être vivant. S’il est vivant, c’est qu’il n’est pas mort : il a su résister. J’ai un très bel exemple récent qui démontre cette intelligence. Des chercheurs de Bristol ont fait une expérience avec une liane qui vrille, la passiflore. Ils posent un tuteur dont elle a besoin pour se développer face à elle. Elle envoie une vrille vers le tuteur (preuve qu’elle le « voit »). Juste avant qu’elle le touche, ils déplacent le tuteur de 5 cm sur la droite. Elle envoie une deuxième vrille vers le nouveau lieu du tuteur. Ils le décalent à nouveau de 5 cm sur la droite. Ils ont fait ça cinq fois. Avant la sixième fois, la liane avait visé 5 cm sur la droite. Ça n’est pas idiot de se demander si les plantes sont plus intelligentes que nous. Nous passons notre temps à dégrader notre environnement et, elles, à améliorer le leur. On se gargarise avec nos avancées technologiques, mais on n’est pas capable de réguler la démographie humaine. On n’y songe même pas, à vrai dire ! Et on pollue, on dégrade profondément la terre, la mer, l’atmosphère…
D’ailleurs, pourquoi les plantes ne se défendent-elles pas
contre nous ?
Je crois que nous sommes tellement récents qu’elles n’ont pas encore pris la mesure de la menace que nous représentons. L’Homo sapiens a entre 200 000 et 300 000 ans. L’évolution se fait dans un temps long. Elles n’ont peut-être pas encore trouvé la solution. Mais le jour où elles l’auront… on sera mal ! (rires)
Avez-vous l’impression que, vingt ans après la publication
d’Éloge de la plante, les mentalités ont changé vis-à-vis des plantes ?
Oui ! Beaucoup ! C’est l’une des raisons d’optimisme aujourd’hui ! La dégradation de notre environnement, la laideur de nos villes et de nos banlieues pousse peut-être à se réfugier vers des choses stables et belles. Les arbres nous permettent de renouer avec le temps long. On les voit changer jour après jour. C’est précieux lorsque l’on vit dans ce temps extrêmement court imposé par l’électronique, les médias.
Quelles solutions le monde végétal pourrait-il nous inspirer
dans ce système au bord de l’effondrement ?
Justement, le temps long. Le silence… Mon ennemi personnel est Aristote. Il était philosophe, il aurait dû se limiter à la philosophie. Ce qu’il a dit des plantes me dégoûte profondément. Il a raconté qu’elles ne savaient pas marcher, ni parler, ce qui est vrai. Mais il en a déduit que c’était des formes de vie inférieures et sans intérêt. Ça date de vingt- cinq siècles ! Et la plupart de mes contemporains voient encore les plantes comme les voyait Aristote ! Je m’emploie à changer cette vision.
Justement, sortez un peu de votre rôle de botaniste et racontez-nous comment sont les gens que vous avez rencontrés dans les forêts primaires.
Ils ne sont pas mieux que nous. Il m’est arrivé de me promener en Guyane avec des Amérindiens qui abattaient les arbres pour en cueillir les fruits… Bon, il y a quand même des gens excellents en Asie tropicale, dans les agroforêts indonésiennes ou thaïlandaises. Ils cultivent leurs forêts de génération en génération. Nous sommes tous d’accord pour dire que les arbres poussent lentement. Alors, à Sumatra, ils ont eu l’idée de planter quatre graines de la même espèce dans un petit carré. Lorsque ça atteint un mètre de haut, ils rejoignent les quatre têtes avec un rafia et ça se soude ; ce qui est très facile et connu. Mais la suite est moins connue : ils en coupent trois et ne gardent qu’une tête qui se nourrit grâce aux systèmes racinaires de quatre arbres. Ça pousse comme une fusée, c’est étonnant. Et vous préservez finalement les quatre arbres, vous n’en tuez aucun puisqu’il reste les racines.
C’est plein de perspectives !
Oui, l’agroforesterie est l’un des rares moments où l’être humain s’occupe de l’arbre en lui faisant du bien. Je ne dirai pas ça de l’agriculture. Je suis certain qu’avec l’agroforesterie, on tient la bonne solution. On a conscience que, sans les arbres, le déficit est énorme. L’arbre stimule la vie dans les sols et c’est exactement de ça dont on a besoin : de sol fertile.